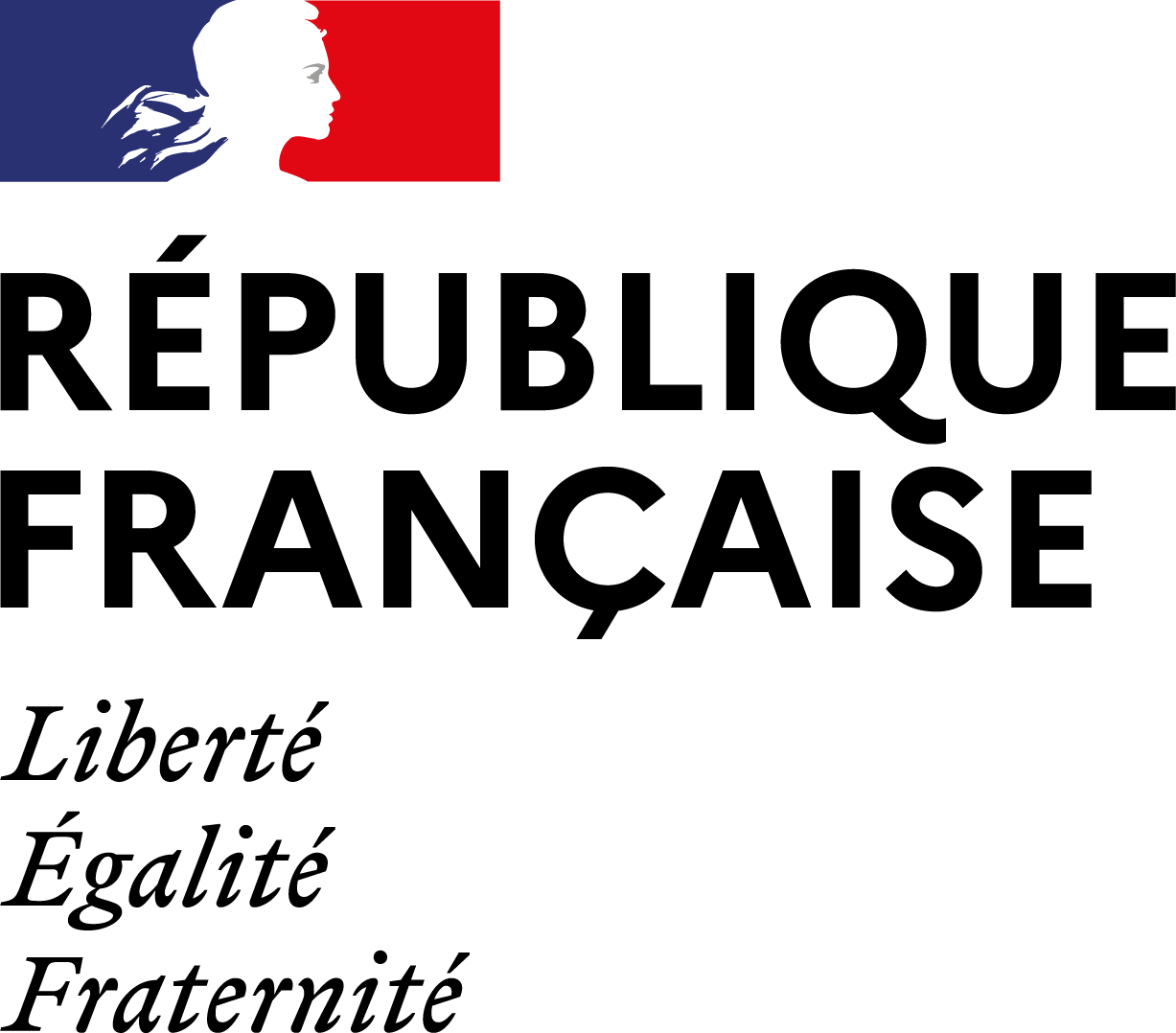Avalanches et changement climatique
Fortement impacté par le changement climatique, le risque Avalanche évolue rapidement. Entre recherche et expertise, la collaboration entre les scientifiques et les multiples acteurs de la prévention est la clé de la connaissance et de l’anticipation des risques actuels et émergents.
Que dit le GIEC
sur les avalanches ?
Connu pour ses synthèses internationales de référence (6ème rapport publié le 9 août 2021) le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) produit également des « rapports spéciaux ». Celui dédié aux océans et à la cryosphère (Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate – SROCC), en 2019, a été le premier comportant un chapitre spécifique sur les zones de montagne.
« Alors que les rapports du GIEC font traditionnellement la part belle aux glaciers et aux milieux polaires, ils ne disaient jusqu’ici presque rien de l’évolution des avalanches et du risque associé en raison d’un manque de résultats disponibles dû à la complexité du problème », expose Nicolas Eckert, chercheur de l’IGE. En effet, pour détecter des changements passés, il est nécessaire de disposer de séries d’observations longues et homogènes, et de les exploiter avec un arsenal statistique relativement avancé.
De même, pour appréhender les évolutions futures de l’activité avalancheuse, il faut convertir les scénarios d’évolution globaux du climat en scénarios locaux d’évolution de la météorologie et de l’enneigement. Cela nécessite d’utiliser des techniques complexes de changement d’échelle et de correction de biais : forçage des modèles régionaux de circulation (CRM) par les modèles généraux (CGM), adaptation à la topographie de montagne, modélisations de l’enneigement à l’aide de modèles physiques corrigés par l’observation. Il est alors possible d’alimenter des relations empiriques entre enneigement et activité avalancheuse établies sur le passé.
Ce rapport, auquel INRAE a contribué, conclut avec un niveau de confiance élevé que les aléas naturels en montagne, dont les avalanches spontanées, se produiront dans le futur dans des lieux et/ou à des saisons où ils ne se produisaient pas jusqu’alors. Cette formulation, fruit d’un compromis scientifique et politique, sans nier la possible réduction locale de l’aléa avec l’enneigement, met l’accent sur les problèmes potentiellement posés par l’évolution rapide dans la localisation spatiale et temporelle des phénomènes dangereux. Ainsi, on s’attend à davantage d’avalanches de neige humide aux altitudes élevées et au cœur de l’hiver, où l’enneigement est pour l’instant préservé.
Cette évolution doit être prise en compte, par exemple, pour adapter les dimensionnements des remontées mécaniques qui pourraient être touchées par des avalanches exerçant potentiellement de fortes pressions en pleine saison touristique.

Prévention des Risques et adaptation aux Changements Climatiques dans les territoires de l'Espace Mont-Blanc
- à donner des réponses méthodologiques et opérationnelles pour gérer les risques naturels en montagne (haute montagne en particulier), via des approfondissements scientifiques et la mise en place d'actions pilotes de gestion des risques à un niveau local ;
- à analyser les nouvelles pratiques sportives et récréatives de la montagne, à l'aune des effets du réchauffement climatique (nouvelles pratiques, éventuelle sur-fréquentation du Massif, nouvelles pratiques sportives...) ;
- à sensibiliser les habitants, les scolaires, les visiteurs, les randonneurs et les alpinistes sur les risques émergents en montagne liés au réchauffement climatique par une approche innovante de capitalisation des expériences acquises en 30 ans de coopération et l'emploi de nouvelles technologies d'information et de sensibilisation (réseaux sociaux, vidéos, 3D,etc.) ;
- à favoriser les échanges transfrontaliers entre responsables des secours en montagne, par des exercices conjoints et la mise en valeur / promotion des Exercices du secours en montagne ;
- à intégrer les professionnels de la communication dans un parcours d'approfondissement et de partage d'expériences avec les scientifiques - techniciens - secouristes ;
- à lancer des stratégies d'adaptation qui, partant d'une approche pilote locale, agissent ensuite comme levier à différents niveaux et puissent permettre aux collectivités locales de s'approprier d'une gouvernance efficace des enjeux.
Le projet PrévRisk-CC voit la Fondation Montagne sûre intervenir en tant que Chef de file, en partenariat avec l'ARPA Vallée d'Aoste, l'Association la Chamoniarde, le CNRS - EDYTEM, INRAE, la Commune de Courmayeur, la CCVCMB (Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc), le Centre Fonctionnel de la Région Autonome Vallée d'Aoste et le Canton du Valais. La contribution d’INRAE concerne spécifiquement les risques glaciaires et le développement d’une méthode de prévision automatisée de l’activité avalancheuse adaptée au contexte Valdotain. Celle-ci utilise des techniques d’intelligence artérielle et est menée en miroir de développements en cours dans les massifs français sur la base de l’information issue de l’EPA (lien). A termes, une approche transfrontalière est visée dont les résultats devraient permettre d’améliorer le BERA dans les deux pays, notamment au niveau des zones frontalières.
PREVRISK_CC est soutenu par l’union européenne avec une subvention FEDER de 2 066 524€, pour un budget total de 2 583 155€.