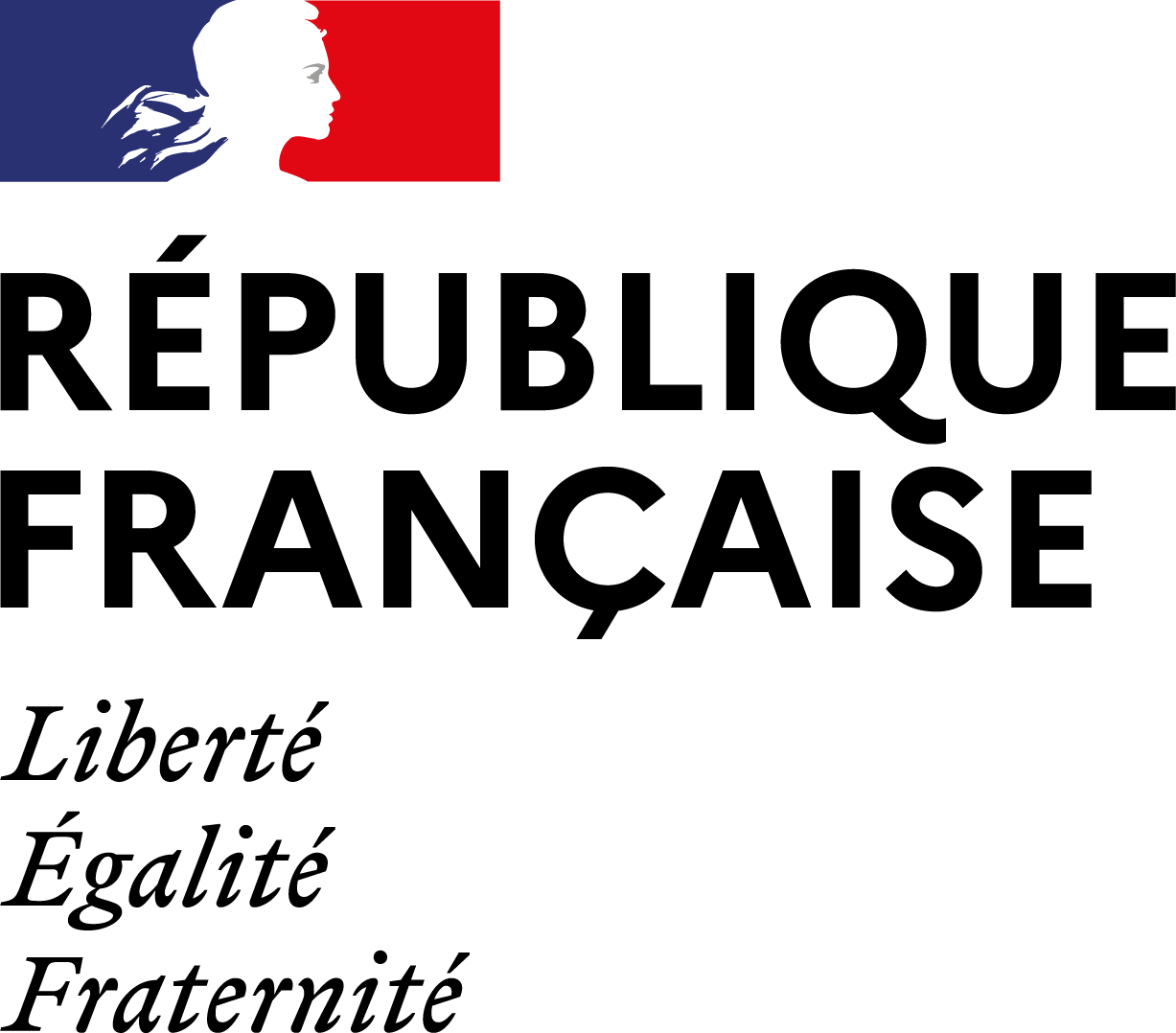FAQ
Photo : Lefras Gwenaël - 2024
Pourquoi s’intéresser aux événements passés ?
La gestion du risque d'avalanche implique la prise en compte de nombreux paramètres : conditions d'enneigement, météorologie, relief du terrain, ouvrages paravalanches, dégâts humains et matériels qui pourraient être occasionnés…
D'une part, elle est basée sur la détermination de l'aléa. Son estimation repose bien souvent sur la mémoire collective.
D'autre part, la gestion du risque doit tenir compte des enjeux, qui peuvent être humains ou matériels. Aléa et enjeux sont difficiles à évaluer, tant dans l'espace que dans le temps.
L'estimation de l'aléa est donc un élément clé de la gestion du risque. Mais dans le cas des phénomènes d'avalanche, il n'existe pas de formule mathématique qui permette de le calculer. Aucun modèle ne peut prédire ce qui peut se passer avec exactitude, dans des conditions données. Les experts et les gestionnaires du risque d'avalanche vont devoir baser leurs conclusions sur des critères incertains. Incertains certes, mais ayant le mérite d'exister… Un des premiers éléments sur lequel s'appuyer est la connaissance des événements passés. En s'inspirant de situations ayant déjà eu lieu, des scénarios peuvent être envisagés. En tant qu'enregistrement des événements passés, l'observation publique des avalanches a un rôle important à jouer. L'EPA, la CLPA et les SSA sont de précieux outils d'aide à la décision. C'est pourquoi la consultation de ces bases de données est fortement conseillée aux gestionnaires des risques d'avalanche.
D'une part, elle est basée sur la détermination de l'aléa. Son estimation repose bien souvent sur la mémoire collective.
D'autre part, la gestion du risque doit tenir compte des enjeux, qui peuvent être humains ou matériels. Aléa et enjeux sont difficiles à évaluer, tant dans l'espace que dans le temps.
L'estimation de l'aléa est donc un élément clé de la gestion du risque. Mais dans le cas des phénomènes d'avalanche, il n'existe pas de formule mathématique qui permette de le calculer. Aucun modèle ne peut prédire ce qui peut se passer avec exactitude, dans des conditions données. Les experts et les gestionnaires du risque d'avalanche vont devoir baser leurs conclusions sur des critères incertains. Incertains certes, mais ayant le mérite d'exister… Un des premiers éléments sur lequel s'appuyer est la connaissance des événements passés. En s'inspirant de situations ayant déjà eu lieu, des scénarios peuvent être envisagés. En tant qu'enregistrement des événements passés, l'observation publique des avalanches a un rôle important à jouer. L'EPA, la CLPA et les SSA sont de précieux outils d'aide à la décision. C'est pourquoi la consultation de ces bases de données est fortement conseillée aux gestionnaires des risques d'avalanche.
Comment peut-on utiliser l’EPA, la CLPA et les SSA dans la gestion du risque d’avalanche ?
De façon idéale, la gestion du risque d’avalanche devrait comporter trois aspects :
Par ailleurs, la connaissance de l’aléa est définie au minimum en fonction de :
Les sites sensibles aux avalanches, SSA, sont plus utiles dans une évaluation du risque avalanches sur des lieux habités.
-
La connaissance de l’aléa, c’est-à-dire des événements potentiellement dangereux qui pourraient survenir.
-
L’évaluation du risque, ou les conséquences que pourrait avoir un événement.
-
La mise en place d’actions pour diminuer le risque : prévention, alerte, évacuation…
Par ailleurs, la connaissance de l’aléa est définie au minimum en fonction de :
-
La connaissance des phénomènes historiques.
-
L’étude géomorphologique des lieux.
-
Les conditions climatiques et météorologiques.
Les sites sensibles aux avalanches, SSA, sont plus utiles dans une évaluation du risque avalanches sur des lieux habités.
Qui peut utiliser l’EPA et la CLPA dans la gestion du risque d’avalanche ?
Ces données sont utilisées pour de nombreuses décisions de prévention et de gestion du risque d'avalanche :
Ces actions sont pour la plupart mises en œuvre par les autorités publiques (Etat, Conseils Régionaux, Conseils Généraux, maires, syndicats, station de ski, EDF, SNCF, sociétés d'autoroute…). Le travail d'exploitation de la CLPA et de l'EPA est souvent confié à un bureau d'étude spécialisé en avalanche.
Mais la gestion du risque d'avalanche est de la responsabilité de tous. Nous pouvons tous être concernés personnellement par le risque d'avalanche. Dans certaines situations, chacun peut contribuer à sa manière à anticiper le risque, voire à réduire les dégâts occasionnés. C'est pourquoi l'intérêt de connaître les phénomènes historiques et donc de consulter l'EPA et la CLPA ne concerne pas uniquement les institutions que nous avons citées. L'information de tous est la première condition pour lutter contre le risque d'avalanche.
- Urbanisme (plan de prévention des risques).
- Gestion de crise (évacuation, plan d'alerte).
- Voies de communication (fermeture et ouverture à la circulation, choix d'emplacement).
- Infrastructures (barrages, lignes électriques, aménagement des stations de ski)…
Ces actions sont pour la plupart mises en œuvre par les autorités publiques (Etat, Conseils Régionaux, Conseils Généraux, maires, syndicats, station de ski, EDF, SNCF, sociétés d'autoroute…). Le travail d'exploitation de la CLPA et de l'EPA est souvent confié à un bureau d'étude spécialisé en avalanche.
Mais la gestion du risque d'avalanche est de la responsabilité de tous. Nous pouvons tous être concernés personnellement par le risque d'avalanche. Dans certaines situations, chacun peut contribuer à sa manière à anticiper le risque, voire à réduire les dégâts occasionnés. C'est pourquoi l'intérêt de connaître les phénomènes historiques et donc de consulter l'EPA et la CLPA ne concerne pas uniquement les institutions que nous avons citées. L'information de tous est la première condition pour lutter contre le risque d'avalanche.
Pourquoi existe-t-il deux manières d’observer les avalanches ?
Historiquement, l’EPA et la CLPA ne sont pas apparues à la même époque et pour les mêmes raisons.
À son origine, l’EPA a été conçue au début du 20ème siècle pour mieux connaître les événements d’avalanche et leurs dégâts sur la forêt. Son principe est d’inventorier tous les événements survenus dans des endroits préalablement choisis : les sites EPA.
Il faut enregistrer alors systématiquement de nombreuses caractéristiques prédéterminées de ces événements. Les informations sont collectées sous forme de textes et de nombres.
Le principal but de la CLPA, depuis 1970, consiste à répertorier, sur une carte et dans des fiches, systématiquement tous les lieux où des avalanches se sont produites par le passé. Les renseignements sont cartographiés en représentant l’ampleur maximale des événements ainsi connus, le plus souvent sous forme de contour-enveloppe, parfois sous forme de trait. Ces différences de principes sont à l’origine de méthodes de travail propres à l’EPA et à la CLPA. Elles engendrent aussi un vocabulaire particulier. Par exemple, on distingue un site EPA d’une emprise CLPA. Malgré ces différences, l’EPA et la CLPA se sont progressivement rapprochées, notamment en utilisant des formats communs pour la présentation des données. En effet, leurs informations sont très complémentaires pour la connaissance des avalanches survenues.
À son origine, l’EPA a été conçue au début du 20ème siècle pour mieux connaître les événements d’avalanche et leurs dégâts sur la forêt. Son principe est d’inventorier tous les événements survenus dans des endroits préalablement choisis : les sites EPA.
Il faut enregistrer alors systématiquement de nombreuses caractéristiques prédéterminées de ces événements. Les informations sont collectées sous forme de textes et de nombres.
Le principal but de la CLPA, depuis 1970, consiste à répertorier, sur une carte et dans des fiches, systématiquement tous les lieux où des avalanches se sont produites par le passé. Les renseignements sont cartographiés en représentant l’ampleur maximale des événements ainsi connus, le plus souvent sous forme de contour-enveloppe, parfois sous forme de trait. Ces différences de principes sont à l’origine de méthodes de travail propres à l’EPA et à la CLPA. Elles engendrent aussi un vocabulaire particulier. Par exemple, on distingue un site EPA d’une emprise CLPA. Malgré ces différences, l’EPA et la CLPA se sont progressivement rapprochées, notamment en utilisant des formats communs pour la présentation des données. En effet, leurs informations sont très complémentaires pour la connaissance des avalanches survenues.
Quelle différence y a-t-il entre un site EPA et une emprise CLPA ?
L'élaboration d'un site EPA et celle d'une emprise CLPA suivent des principes différents :
Les sites EPA sont choisis alors que les emprises CLPA sont constatées. Il s'agit donc en général de 2 zones géographiques qui ne se superposent pas exactement et qui sont numérotées indépendamment.
- Dans le cas d'un site EPA, on va d'abord définir une zone géographique, puis on va y observer tous les événements qui s'y produisent. Cette zone est définie approximativement afin de n'exclure aucun événement futur. De plus elle n'est pas fermée vers la vallée.
- Pour délimiter une emprise CLPA, on cherche les événements les plus étendus que l'on connaisse, puis on en représente les limites les plus larges. Cette zone est beaucoup plus précise : elle est basée sur des événements existants dont on a connaissance.
Les sites EPA sont choisis alors que les emprises CLPA sont constatées. Il s'agit donc en général de 2 zones géographiques qui ne se superposent pas exactement et qui sont numérotées indépendamment.
Quelle est leur valeur juridique ?
Lors de la création des CLPA, la circulaire n° 71-409 du 24 août 1971 a défini comment devraient être utilisées ces cartes :
« Déposées en mairie, les cartes inventaire des avalanches sont tenues à la disposition de tous ceux qui désirent les consulter.
Vis-à-vis des particuliers, elles n'ont ainsi qu'une valeur de renseignement.
Transmises à toutes les administrations concernées, elles constituent dans la pratique des documents de base en vue de l'établissement des "plans de zones exposées" [précurseurs des PPR], qui seront préparés sous la responsabilité conjointe des directeurs départementaux de l'Agriculture et de l’Équipement et qui serviront à définir les servitudes correspondantes à inscrire aux plans d'occupation du sol.
Cependant, en attendant la mise au point de ces derniers documents qui seront soumis à l'enquête publique, les administrations et collectivités locales devront tenir compte des renseignements des cartes d'avalanches à l'occasion de toute décision particulière sur les travaux publics et opérations d'intérêt général».
La CLPA, comme l'EPA d'ailleurs, est donc un document informatif qui inventorie un ensemble de faits observés, sans donner d'indication directe sur le risque. Il s'agit de document d'étape dans la construction des PPR (plan de prévention des risques) ou des PLU (plan local d'urbanisme). Leur utilisation n'est pas imposée à tous mais elles ont une valeur d'information extrêmement importante pour toutes les personnes concernées par le risque d'avalanche.
Dans le contexte judiciaire, les CLPA sont parfois utilisées « comme moyen de preuve lors d'un procès » pour « démontrer que l'événement était prévisible puisque connu et inventorié dans la carte » (Source : Anena). Pour en savoir plus sur la CLPA et le droit, consulter la rubrique Jurisque sur le site de l'Anena ou encore de l'IRMa. De plus, tous les textes réglementaires sont consultables sur le site Legifrance.
« Déposées en mairie, les cartes inventaire des avalanches sont tenues à la disposition de tous ceux qui désirent les consulter.
Vis-à-vis des particuliers, elles n'ont ainsi qu'une valeur de renseignement.
Transmises à toutes les administrations concernées, elles constituent dans la pratique des documents de base en vue de l'établissement des "plans de zones exposées" [précurseurs des PPR], qui seront préparés sous la responsabilité conjointe des directeurs départementaux de l'Agriculture et de l’Équipement et qui serviront à définir les servitudes correspondantes à inscrire aux plans d'occupation du sol.
Cependant, en attendant la mise au point de ces derniers documents qui seront soumis à l'enquête publique, les administrations et collectivités locales devront tenir compte des renseignements des cartes d'avalanches à l'occasion de toute décision particulière sur les travaux publics et opérations d'intérêt général».
La CLPA, comme l'EPA d'ailleurs, est donc un document informatif qui inventorie un ensemble de faits observés, sans donner d'indication directe sur le risque. Il s'agit de document d'étape dans la construction des PPR (plan de prévention des risques) ou des PLU (plan local d'urbanisme). Leur utilisation n'est pas imposée à tous mais elles ont une valeur d'information extrêmement importante pour toutes les personnes concernées par le risque d'avalanche.
Dans le contexte judiciaire, les CLPA sont parfois utilisées « comme moyen de preuve lors d'un procès » pour « démontrer que l'événement était prévisible puisque connu et inventorié dans la carte » (Source : Anena). Pour en savoir plus sur la CLPA et le droit, consulter la rubrique Jurisque sur le site de l'Anena ou encore de l'IRMa. De plus, tous les textes réglementaires sont consultables sur le site Legifrance.